La guerre au temps de la “cancel culture”
Lors
du déclenchement de l’invasion de l’Irak en 2003, j’étais en
déplacement professionnel aux Etats-Unis. C’était une expérience
effrayante. A la radio, à la télévision, dans les journaux, tout était
bourrage de crâne. L’ordre de ne pas montrer les cadavres, et on ne les
montrait pas. L’ordre de ne pas parler de « victimes civiles » mais de
« dommages collatéraux », et tout le monde utilisait cette expression.
L’ordre était de diaboliser la figure de Saddam Hussein, et on le voyait
ciblé sur des affiches, des t-shirts, des émissions de télévision.
L’ordre était de ne donner aucune information, juste des récits
émouvants : des témoignages de soldats américains dans le rôle de
libérateurs, des récits d’irakiens racontant les horreurs que leur
faisait subir Saddam Hussein, des histoires de victoires épiques.
Mais
de qui venaient ces « ordres » ? La démocratie américaine ne
permet-elle à chacun de s’exprimer librement ? Oui, bien entendu. Mais
comme disait Adlaï Stevenson, « une société libre est une société où il
n’est pas dangereux d’être impopulaire ». Et à l’époque, ne pas suivre
le courant était pour le moins périlleux. Car ceux qui n’étaient pas
dans le camp du Bien étaient forcément dans le camp du Mal, et traités
comme tels. La France avait voté contre l’intervention à l’ONU ? Les
« french fries » étaient rebaptisées « liberty fries », les magasins et
produits français ostensiblement boycottés, les français se faisaient
interpeller et cracher dans la rue, et on croisait des gens qui
portaient fièrement sur leur t-shirt une bombe surmontant la formule
menaçante « today Baghdad, tomorrow Paris ».
Je
pensais que cette hystérie était tout américaine. J’avais tort : la
guerre en Ukraine a montré à quel point notre vieille Europe goûte aussi
aux plaisirs équivoques de l’indignation morale à l’américaine. Vous
trouvez ridicule de rebaptiser les « french fries » en « liberty
fries » ? Et bien, que pensez-vous de l’annulation d’une conférence de
l’écrivain Paolo Nori à l’université de Milan, au prétexte que le thème
de la conférence était… Fédor Dostoïevski, écrivain certes Russe, mais
dont la mort en 1881 l’empêche de prendre position dans le conflit en
cours ? Et ce n’est pas un cas unique, loin de là. Le chef d’orchestre
Valeri Gergiev, considéré comme l’un des plus grands maestros vivants,
est sommé de signer des déclarations condamnant son pays, sous peine de
se voir licencié ou interdit de scène. Et ce n’est pas une menace en
l’air : Gergiev ayant refusé de se soumettre à ce qu’il faut bien
appeler une procédure inquisitoriale, a été dûment licencié et ses
concerts annulés. La soprano Anna Netrebko refuse de condamner la
politique extérieure de son pays ? Elle est déprogrammée. Elle accepte
finalement de signer un communiqué contenant la condamnation demandée,
elle est reprogrammée. Un évènement organisé par l’industrie spatiale
américaine et traditionnellement appelé « la nuit de Youri » en mémoire
du cosmonaute Youri Gagarine s’est vue rebaptisée en « nuit de ce qui
vient après ». Des expositions de tableaux issus de collections russes
sont contestées, des festivals de cinéma russe annulés. La Cardiff
Orchestra, au pays de Galles, annule un concert où elle devait jouer des
œuvres de Tchaïkovski (1). Même chose à la philharmonie de Zagreb. Et
on pourrait allonger la liste à l’infini.
Vous
me direz qu’il a toujours été ainsi. C’est faux : alors qu’en 1940
Londres était sous les bombes, on y a continué à jouer Haendel ou Bach.
Encore plus emblématique : l’indicatif des émissions « les Français
parlent aux Français » sur la BBC reprenait les premiers accords de la 5ème symphonie
d’un musicien allemand nommé Beethoven. Imagine-t-on aujourd’hui la
résistance ukrainienne reprendre comme indicatif un air de Tchaïkovski ?
On notera par ailleurs que rien de tel n’était arrivé en 2003, lorsque
l’armée américaine s’est lancée à l’assaut de l’Irak. Les orchestres
américains ont continué à jouer en Europe, les films américains à sortir
en salle, les artistes américains à se produire dans le monde entier.
Tout
ça pourrait être amusant si ce n’était pas aussi grave. Car on ne se
vautre pas dans les joies de l’indignation morale impunément.
L’indignation morale, qui est l’autre face de la « cancel culture » est
l’illustration de la dégradation de notre vie démocratique. Car vivre en
démocratie implique nécessairement accepter le fait que nos sociétés
sont diverses, avec une multiplicité d’intérêts qui sont tantôt
complémentaires, tantôt antagoniques, et qui donnent naissance à des
cadres idéologiques, des opinions et des projets politiques qui peuvent
être diamétralement opposés. La démocratie est censée permettre la
coexistence pacifique ce ces différences.
Mais
comme le signale Alain-Gérard Slama dans « Le siècle de monsieur
Pétain » (2), une telle logique est particulièrement exigeante. Elle
implique d’accepter la différence et le conflit comme faisant partie de
la vie normale de nos sociétés, et fait de la politique comme une
recherche permanente d’un équilibre toujours précaire. Le débat
démocratique est par essence une prise de risque, le risque que l’autre
ait, au moins en partie, raison. Ou du moins, ses raisons.
Or,
les gens détestent le risque. Au doute, ils préfèrent la certitude. Et
c’est pourquoi les discours unanimistes, qui proposent une société
« apaisée » autour d’idées partagées par tous – ce qui suppose
l’élimination des hérétiques, qu’elle soit physique ou symbolique –
séduit toujours autant. Cet unanimisme nous dispense de nous poser des
questions – comment pourrions-nous nous tromper alors que tout le monde
est d’accord avec nous ? – et nous rassure donc sur le fait que nous
sommes du côté du Bien. C’est un cocon bien commode, une bulle où tout
ce que nous lisons, ce que nous écoutons, confirme jour après jour que
nous sommes dans le Vrai.
Une
telle vision est, par nature, totalitaire. La diversité des projets
reflétant une diversité irréductible d’intérêts, on ne peut atteindre le
« consensus » en question que si l’on exclut – ou l’on réduit au
silence – toute position dissidente, voire si l’on rend toute dissidence
impensable (3). Et la « cancel culture » sert précisément à cela : en
supprimant tout ce qui n’est pas conforme à une description du monde,
elle construit un environnement idéologiquement aseptisé où rien ne
vient « offenser » le consensus et donc planter le doute. Quand Von der
Leyen justifie l’interdiction de RT par sa volonté d’empêcher « les
mensonges d’affaiblir notre Union », on entend les échos des « mensonges
qui nous ont fait tant de mal » dont parlait naguère par le Maréchal.
Tous ces discours ont un point commun : la force est dans l’unanimité.
Si Von der Leyen veut faire taire ces discours, ce n’est pas parce
qu’ils sont « mensongers », mais parce que le mensonge en question
« affaiblit notre Union ». Cela pose une question : si une « vérité »
venait à « affaiblir notre Union », faudrait-il l’interdire aussi ? La
réponse fournie par nos autorités européennes est évidente : ce qui
« affaiblit notre Union » ne peut être une « vérité », et cela par
définition. « Il n’y a pas de décision démocratique contre les traités
européens », comme disait Juncker…
Cette
recherche de l’unanimité nécessite qu’on abolisse la raison, qu’on ne
s’adresse qu’à l’émotion. La raison est nécessairement diverse, parce
que chacun a ses raisons. Mais l’émotion est unanime. Exposez une
explication, et vous entendrez s’exprimer les accords et les désaccords.
Montrez une une femme en pleurs tenant dans ses bras son enfant mort,
et vous susciterez une réaction unanime. C’est ce que tous les grands
démagogues de l’histoire ont compris. Et c’est exactement ce qui se
passe aujourd’hui : regardez les informations télévisées, lisez les
journaux. Sur l’Ukraine, vous ne trouverez guère d’analyses ou
d’explications. Vous ne trouverez que des témoignages : ici, un grand
gaillard avec l’uniforme ukrainien qui vous explique qu’il se battra
jusqu’à la mort et que les projets de Poutine sont voués à l’échec ; là,
deux adolescentes ukrainiennes qui vous expliquent comment elles
diffusent les « vraies informations » sur les réseaux sociaux pour faire
face à la propagande russe ; plus loin, un citoyen pleure sa famille
installée à Marioupol et dont il n’a pas de nouvelles depuis plusieurs
semaines.
Ces
témoignages n’apportent en fait aucune information. Dans n’importe
quelle guerre, on trouvera des mères pleurant leur enfant, des gaillards
se promettant la victoire, des adolescents persuadés de sauver le
monde. On aurait certainement pu trouver les mêmes témoignages en Irak
après l’intervention américaine, en Serbie après les bombardements de
l’OTAN… cela ne nous informe en rien sur le conflit en cours. Le seul
effet de ces « informations », c’est de provoquer une réaction
sentimentale et unanime, de noyer toute interrogation rationnelle
derrière l’émotion.
Prenons
un exemple précis, si vous le voulez bien, qui montre clairement
combien cette forme « d’information » est, en absence de toute mise en
perspective, manipulatrice. Dans son numéro daté du vendredi 16 mars, le
journal « Le Monde » publie en « une », sous le titre « Guerre en
Ukraine : le martyre de Marioupol » une photo sur quatre colonnes,
présentant une femme assise sur un matelas dans ce qui pourrait être un
couloir d’hôpital, avec un enfant endormi dans ses bras. La photo porte
la légende suivante : « Une femme et son enfant, dans un hôpital de
Marioupol, le 11 mars. Elle pleure la mort de son autre enfant dans les
bombardements ».
Le
lecteur sentimental ne peut que sentir les larmes aux yeux devant cette
image de détresse ainsi expliquée. Mais le lecteur cynique et cartésien
que je suis se pose immédiatement une question : comment le rédacteur a
fait pour savoir que cette femme « pleure la mort de son autre enfant
dans les bombardements » ? Sauf à lire dans les pensées de la femme en
question, il est impossible d’affirmer qu’elle pleure pour cette raison
plutôt qu’une autre, à moins qu’un journaliste présent ait été
suffisamment insensible pour aborder cette femme dans sa détresse et lui
demandé « vous pleurez pour quoi, exactement » ?
Cette
photo et sa légende sont révélatrices d’une dérive manipulatrice parce
qu’on utilise ici l’image pour lui faire dire ce qu’elle ne dit pas par
elle-même (4). Le texte d’accompagnement exploite l’émotion suscité par
la photo et la dirige dans un but précis. Un texte qui a toutes les
chances, pour les raisons expliquées plus haut, d’être une invention du
rédacteur à partir d’une rumeur plus ou moins vérifiée.
L’utilisation
systématique du témoignage est en elle-même une forme de manipulation,
parce que le témoignage que vous publiez a toujours comme contrepartie
celui que vous ne publiez pas. Lorsque vous publiez une analyse, vous
risquez toujours la contradiction. Mais lorsque vous publiez un
témoignage, c’est sans risque. On ne peut pas contredire un témoin,
puisque le témoin n’expose que son point de vue. Une analyse tendant à
montrer que Poutine est fou peut être remise en cause, un paysan
ukrainien qui affirme devant la caméra « je pense que Poutine est fou »
exprime un fait incontestable : non pas que Poutine est fou, mais qu’il
pense qu’il l’est. Or, vous trouverez des témoins pour dire tout et son
contraire. En sélectionnant avec soin ceux que vous publiez et ceux que
vous occultez, vous pouvez fabriquer une réalité virtuelle. Ainsi, par
exemple, on nous a montré les funérailles à Lvov de soldats ukrainiens
dans une église réservée à l’armée. Tout y était : les drapeaux
ukrainiens, les familles en pleurs, les collègues des disparus affirmant
leur foi dans la victoire. C’était émouvant.
Un
Russe n’a-t-il pas des yeux ? Un Russe n’a-t-il pas, comme un
Ukrainien, des mains, des organes, des dimensions, des sens, des
affections, des passions ? N’est-il pas nourri de la même nourriture,
blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les
mêmes remèdes, réchauffé et glacé par le même été et le même hiver ? Si
vous le piquez, ne saigne-t-il pas ? Si vous le chatouillez, ne rit-il
pas ? Si vous l’empoisonnez, ne meurt-il pas ? Et si vous lui faites du
mal, ne se venge-t-il pas ? » (5). Bien sur que si. Les funérailles des
soldats russes tombés pour leur patrie sont probablement tout aussi
émouvantes que celles des soldats ukrainiens. Mais on ne le montrera
pas, et pour une très bonne raison : la vision manichéenne du Bien
contre le Mal ne tient que si l’on déshumanise l’ennemi. Dès lors qu’on
lui reconnaît la capacité à penser, à aimer, à souffrir, l’ennemi
redevient humain, et la vision manichéenne se fracture. La manière dont
la figure de Poutine – un fou incapable d’aimer ou de souffrir – est
construite est d’ailleurs assez révélatrice de cette volonté de
déshumanisation indispensable au maintien de la fiction d’une lutte du
Bien contre le Mal.
Si
ce discours fonctionne, c’est parce que notre société fragmentée a
envie, désespérément envie, de communion. Divisée en groupes, lobbies et
communautés prêtes en permanence à marquer leur différence pour
affirmer leur statut victimaire, il reste peu choses pour nous réunir.
Et ce lien nous manque. Si l’attaque terroriste contre Charlie Hebdo a
fait sortir près de quatre millions de Français dans la rue, c’est en
partie pour défendre les libertés. Mais c’est aussi parce qu’une
occasion nous était donnée enfin d’être ensemble derrière un drapeau
commun. Et nous avions à l’époque été surpris lorsque nous avons
constaté que le consensus derrière ce drapeau était moins unanime que
nous ne le pensions. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine nous donne une
nouvelle opportunité de nous donner l’illusion de l’unité.
Les
crises pointent souvent avec cruauté les projecteurs sur nos
faiblesses. On parle beaucoup de l’américanisation de nos sociétés,
l’hystérie antirusse qui domine nos médias en illustre à la perfection
les ravages. Dans son discours à l’ONU, Dominique de Villepin avait à
juste titre parlé de ces « vieux pays », qui pouvaient se reposer sur
les leçons d’une histoire millénaire pour ne pas céder au diktat de
l’émotion et pour représenter la voix de l’intelligence. Ce n’est plus
le cas. L’oubli volontaire de notre histoire nous a rajeunis au point de
nous infantiliser.
Descartes
(1)
La justification publiée par l’orchestre en question est d’ailleurs
très drôle : d’une part, il paraît que l’un des musiciens de l’orchestre
a de la famille en Ukraine, de l’autre, le programme incluait la
« marche slave » et « l’ouverture 1812 », œuvres qui « célèbrent les
prouesses militaires russes ». Avouez que c’est croquignolet…
(2) « Le siècle de monsieur Pétain », Perrin, 2005. Un livre que je vous recommande très chaleureusement.
(3)
La référence ici est bien entendu le 1984 de George Orwell, et l’idée
que la transformation du langage permet de rendre certaines idées
inconcevables car inexprimables. On peut s’émouvoir devant les
souffrances d’une victime, mais un « dommage collatéral » peut-il
souffrir ?
(4)
C’est d’ailleurs l’une des règles fondamentales du photojournalisme.
Une bonne photo de presse ne porte jamais de légende (autre que le lieu
et la date de prise du cliché) parce qu’elle doit se suffire à
elle-même. Prenez la célèbre photo de Nick Hut présentant une fillette
fuyant la destruction de son village au Vietnam en 1972. Vous imaginez
cette photo légendée « Petite fille pleurant parce qu’elle est brulée au
napalm lors des bombardements américains » ? Non, bien sûr que non. La
photo est entrée dans l’histoire parce qu’elle dit tout sans besoin
qu’on vous l’explique.
(5)
Pour ceux qui ne l’auraient pas reconnu, Shakespeare, « Le marchand de
venise », acte III, scène I, légèrement retouché pour coller à
l’actualité…



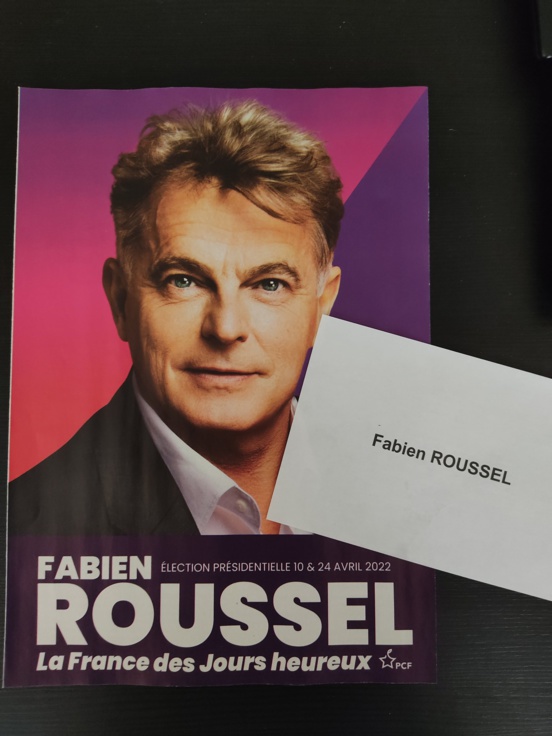




/image%2F1449569%2F20220407%2Fob_bc3478_boutcha-reuters.jpg)