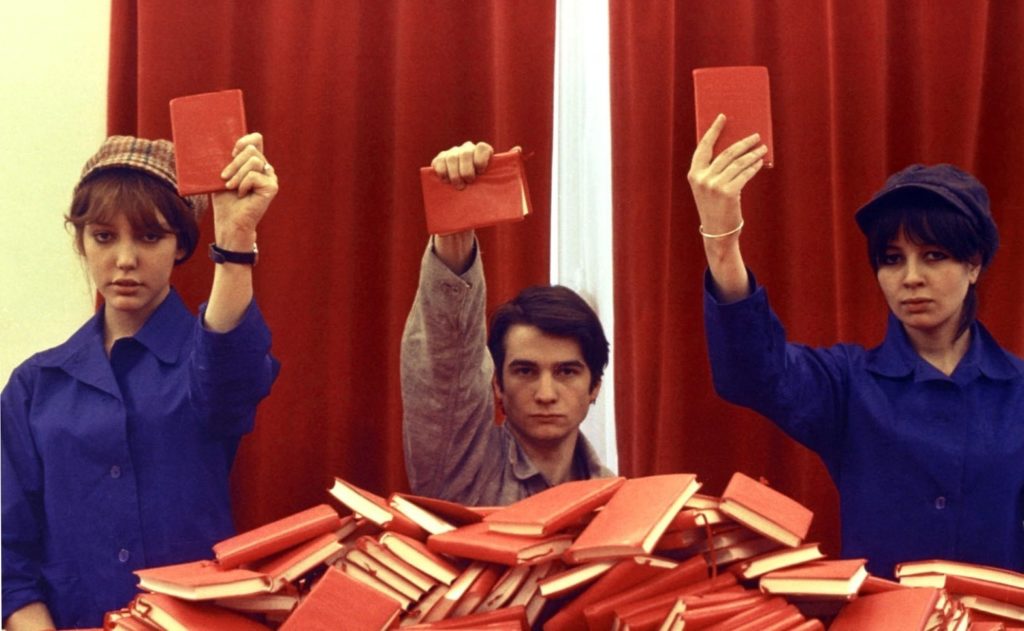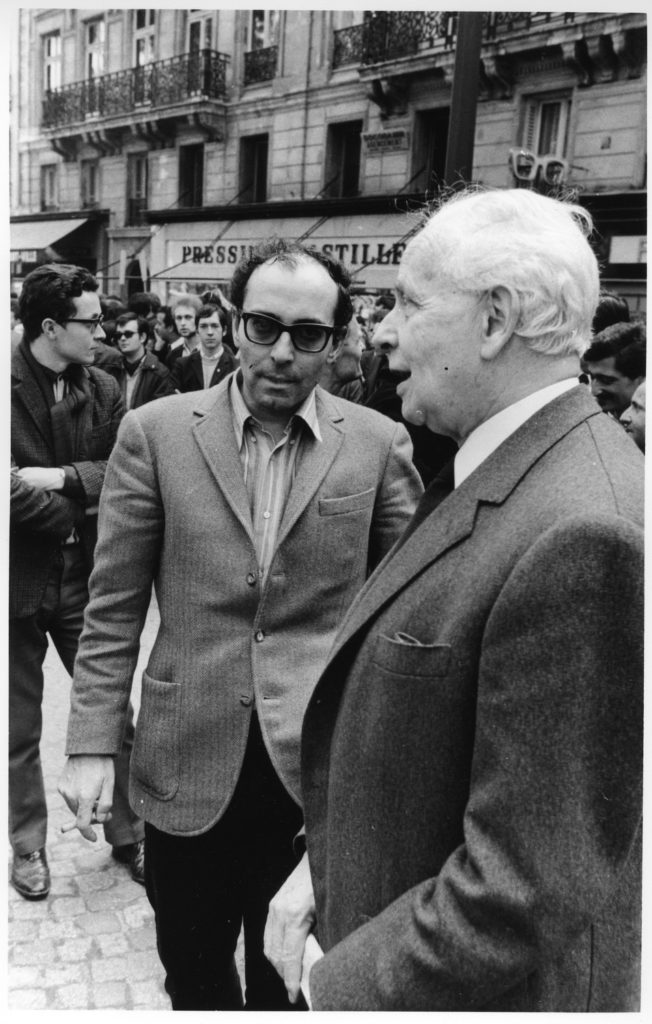C’est
une petite musique qui revient à chaque réunion en vue d’une
mobilisation dans l’Éducation nationale : au-delà des réformes touchant
le cycle général, il s’agirait de ne pas en oublier une autre, celle de
la voie professionnelle. Il faut dire que dans le grand bouleversement à
l’œuvre dans l’Éducation nationale depuis 2017, le lycée professionnel
n’a pas été épargné. Ses enseignants ne cessent depuis cinq ans
d’alerter sur leurs conditions de travail, et les récentes déclarations
d’Emmanuel Macron n’ont rien pour les rassurer.
Alors candidat à
sa réélection, le président de la République avait promis, en avril,
« une révolution complète du lycée professionnel ». Un mot d’ordre qu’il
a réitéré jeudi 25 août, dans son discours devant les recteurs, en
valorisant le modèle de l’apprentissage et en augmentant d’au moins 50 %
les temps de stage (qui devront être rémunérés « de manière
correcte »).
Rapprocher le bac pro de l’entreprise
But
de la réforme : « ré-arrimer, très en profondeur et en amont, les
lycées professionnels avec le monde du travail » et « adapter aux
besoins du marché du travail et des élèves, nos formations ». Avec en
ligne de mire l’objectif plus global de dépasser le million d’apprentis
(730 000 aujourd’hui) afin d’améliorer l’insertion des jeunes.
Un
projet qui suscite l’inquiétude de la communauté éducative. « Brandir
l’apprentissage en exemple à suivre, c’est oublier que le lycée
professionnel se compose de jeunes âgés de 15 à 18 ans dont la majorité
est en tension avec le scolaire et n’est pas prête à entrer dans le
monde dans l’entreprise, souligne Stéphane Crochet, secrétaire général
du Se-Unsa. Doubler le temps passé en stage interroge profondément sur
le temps qu’il reste pour les enseignements généraux. »
Parmi les
65 000 enseignants de la voie professionnelle, beaucoup redoutent
également une organisation des filières en fonction des besoins de
l’économie locale de chaque établissement. « Il vous faudra donc revoir,
en lien avec les régions, la carte des formations, assumer ensemble de
fermer celles qui n’insèrent pas, et développer celles qui marchent » a
en effet intimé le Président aux recteurs d’académie réunis jeudi
dernier.
Autre motif d’inquiétude : un décret publié en juin
dernier a élargi les champs d’exercice des professeurs de lycée
professionnel. Ils peuvent désormais enseigner dans les cycles général
et technologique, en collège ainsi que dans le supérieur.
Pour
Vincent Magne, représentant de l’Association des professeurs d’histoire
et de géographie (APHG), il s’agit avant tout d’un « moyen de faire de
la gestion de flux » :
« Ce décret facilite la suppression des
postes qu’engendrera l’augmentation des périodes de stages. Les
professeurs seront simplement redéployés dans les collèges où la pénurie
de moyens bat son plein », prédit-il.
Co-tutelle des ministères du Travail et de l’Education
Symbole
du renforcement souhaité de l’expérience en entreprise : le placement
de la ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation
professionnels Carole Grandjean sous la double tutelle d’Olivier
Dussopt, ministre du Travail, et de Pap Ndiaye, à la tête du
portefeuille de l’Education. Une manœuvre qui a été accueillie de
manière contrastée au sein des syndicats.
Le Snuep-FSU a ainsi regretté qu’une « ligne rouge » ait été franchie :
« Cette double tutelle est un mauvais signe dans un contexte actuel de
désengagement progressif de l’État des missions de services publics
d’éducation », estime Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale du
Snuep-FSU, qui y perçoit « une forme d’externalisation » des 650 000
élèves professionnels en dehors du giron de l’Éducation nationale, et
« une volonté de transformer les lycées professionnels en centres
d’apprentissage. »
Inversement, le Snetaa-FO (majoritaire) a salué
le « symbole fort » d’une « priorité donnée à l’enseignement et la
formation professionnels », même si Pascal Vivier, secrétaire général du
Snetaa-FO redoute un « coup de com » :
« Nos élèves arrivent
avec de lourdes difficultés scolaires dont le lycée professionnel est le
réceptacle. Penser que les transformer en apprentis, de la main-d’œuvre
bon marché, suffira à endiguer le décrochage est un leurre. »
Dans la lignée des précédentes réformes
Créé
en 1985, le baccalauréat professionnel n’a depuis cessé d’être réformé.
Celle de 2009, menée sabre au clair par Luc Châtel, avait déjà fait
passer de quatre à trois ans la durée des enseignements. En 2018-2019,
Jean-Michel Blanquer avait à nouveau allégé les volumes horaires des
enseignements généraux (maths, français, langue vivante), une partie de
ces cours devant être réalisée en « co-intervention » avec des
enseignants des matières professionnelles.
L’année de seconde
était par ailleurs devenue une année de découverte d’une famille de
métiers, retardant la spécialisation à l’année de première avec, déjà,
une volonté d’accroître le nombre de formations en apprentissage et d’en
faire des « filières d’excellence ».
En trente-cinq ans, les
élèves de la voie professionnelle ont ainsi perdu 1 370 heures
d’enseignement général et professionnel sur tout le cycle.
En
découle, pour les professeurs en charge des matières générales, une
perte de sens du métier et le sentiment de ne plus pouvoir offrir des
enseignements de qualité.
« Ces transformations sont guidées par
des visions purement utilitaires. On revient à l’obsession
patron-ouvrier du XIXe siècle selon laquelle un ouvrier doit bosser, et
ne surtout pas réfléchir », dénonce Vincent Magne, représentant de
l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG).
« Peut-être n’en ferons-nous pas des historiens, mais nous devons les
former à devenir les citoyens de demain », insiste l’enseignant de
lettres et histoire-géographie – deux domaines rassemblés en une seule
discipline dans les filières professionnelles – à Troyes.
Depuis
la réforme de Jean-Michel Blanquer, un élève sortant du baccalauréat
professionnel n’a eu seulement qu’1 heure 15 de français par semaine.
Pour un élève de CAP c’est à peine 45 minutes.
Élèves en difficulté
Julie
Delphigué-Giraud, professeure d’éco-gestion au lycée de
Camblanes-et-Meynac (Gironde) déplore, elle, un manque de concertation
avant une telle refonte. L’enseignante y perçoit une « grande
méconnaissance du profil social des élèves et de leurs difficultés
scolaires ». En 2016, le Cnesco avait établi que 60 % des élèves de la
voie professionnelle sont des enfants d’ouvriers, et seulement 12 % des
enfants de cadres.
Les données du ministère de l’Education
nationale montrent également qu’en 2021, les lycées professionnels ont
accueilli 39 % élèves boursiers, contre 26,5 % en filière générale, avec
de surcroît un « retard » d’âge fréquent (33 % des inscrits en seconde
pro et 62,6 % en première année de CAP).
Julie Delphigué-Giraud
pointe une autre difficulté encore peu abordée mais prégnante dans le
discours des enseignants : la sur-représentation des élèves porteurs de
handicap. Cette année, sur ses 26 élèves, 11 étaient en situation de
handicap – certains avec des déficiences intellectuelles lourdes, ce qui
complique la conduite des apprentissages.
Pour Christian Sauce,
ex-professeur de lettres et d’histoire-géographie, la dégradation de la
voie professionnelle n’est autre que le résultat d’une dégradation
continue et orchestrée.
« L’apprentissage explose, dopé par
l’argent public, tandis que le lycée professionnel se meurt par la
volonté des pouvoirs publics », résume-t-il dans une formule lapidaire.
Les
premiers chiffres du projet de loi de finances 2023, transmis le lundi 8
août au Parlement, lui donnent plutôt raison. Le ministère du Travail
devrait bénéficier d’une hausse de crédits de 6,7 milliards d’euros pour
la prolongation des aides à l’embauche des apprentis, lancées à l’été
2020 et qui devaient s’éteindre le 30 juin dernier.
Leur montant a
été calculé afin que l’opération ne coûte presque rien à l’employeur,
soit 5 000 euros pour le recrutement en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation d’un mineur, et 8 000 pour les alternants majeurs
peu importe le diplôme poursuivi ou la taille de l’entreprise. Une
réussite si l’on en croit la hausse spectaculaire du nombre de contrats
signés : plus de 730 000 en 2021, contre 290 000 cinq ans plus tôt.
Quantité ou qualité de l’apprentissage ?
Mais
tandis que le chef de l’État vante les mérites de l’apprentissage comme
tremplin vers le plein-emploi, la Cour des comptes dresse un bilan en
demi-teinte. Dans un rapport publié en juin sur la formation en
alternance, celle-ci pointe des « taux de rupture de contrats
d’apprentissage particulièrement élevés » en général, et notamment dans
la filière pro (39 % pour les CAP, 32 % pour les bac pro), même si la
majorité des apprentis rebondissent finalement via un autre contrat.
Surtout,
on y apprend que la hausse globale des effectifs d’apprentis est en
réalité « un succès quantitatif principalement porté par l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur » – représentant 51 % des apprentis en
2020 – et le secteur tertiaire.
Par ailleurs, l’impact de
l’apprentissage sur l’insertion et la carrière des jeunes reste mal
connu et, pour ce que l’on en sait, relativement ambivalent, comme le
notait la Cour des Comptes. Une étude qui vient de paraître dans la
revue Éducation et Formations montre qu’être passé par une formation en
apprentissage « augmente la probabilité d’occuper un emploi, des
diplômés du second cycle jusqu’à la trentaine » mais a, en revanche,
« peu d’impact, voire un léger effet défavorable, sur celle des plus
âgés ».
La « double tutelle » des ministères Éducation-Travail
doit enfin permettre de pouvoir initier un changement au collège. Des
établissements volontaires pourront proposer, dès cette rentrée, des
« activités de découverte de métiers » à partir de la classe de
cinquième, a spécifié la rue de Grenelle dans sa circulaire de rentrée
2022. Une mesure qui peut sembler de bon augure a première vue, mais qui
laisse les syndicats sur la défensive.
« Normalement il devrait y
avoir des dissensions fortes entre les objectifs du ministère du
Travail et du ministère de l’Éducation nationale. S’il n’y en a pas,
c’est que l’on est bien dans un registre d’instrumentalisation de la
formation des jeunes pour satisfaire des besoins économiques locaux »,
conclut Sigrid Gérardin du Snes-FSU.
Source https://www.alternatives-economiques.fr/lycees-pro-toujours-plus-soumi...


/image%2F1385629%2F20220913%2Fob_758b38_4843362944605852926.jpg)
/image%2F0618370%2F20220914%2Fob_1b054d_l220910c-small.jpg)