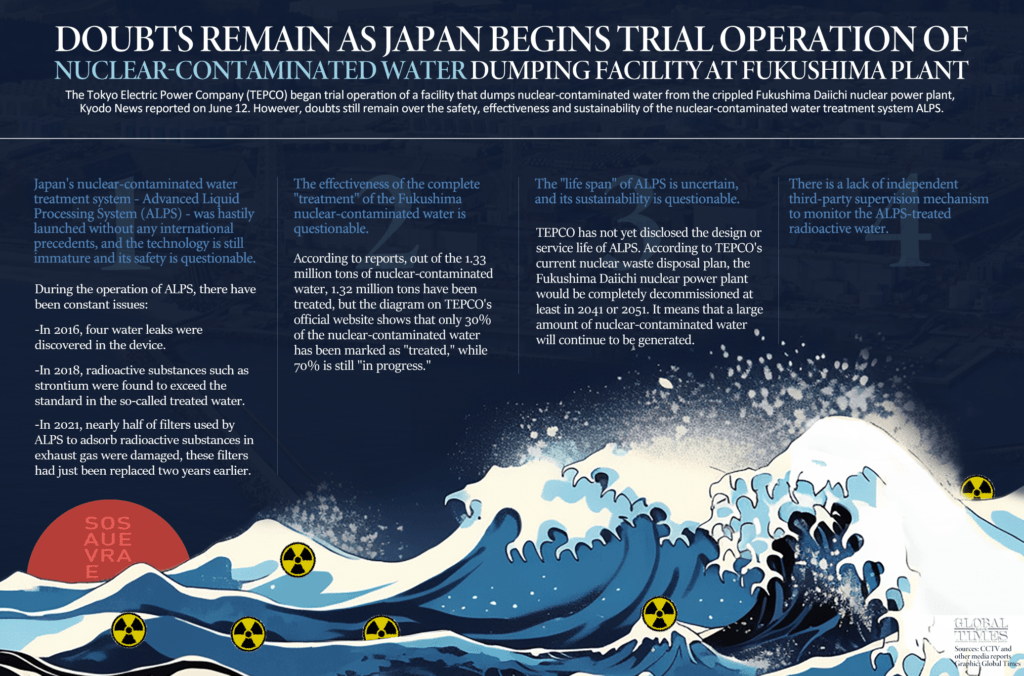Or, Poutine n’est ni un idéologue fanatisé (des politiques de cette
nature se sont révélées marginales dans tout l’espace post-soviétique
depuis deux décennies), ni un fou. Et il faut bien admettre qu’il ne
s’est pas outre mesure émancipé de l’agenda de la classe dominante
russe… Mais quel est-il ?
Le capitalisme politique – en Russie et ailleurs
Qui dirige la Russie ? Un marxiste répondrait que « la classe capitaliste » est aux manettes. Un quidam
de l’espace post-soviétique s’en prendrait aux « voleurs, escrocs,
mafieux ». Une réponse plus médiatique consisterait à faire référence
aux « oligarques » – terme qui met en évidence l’interdépendance entre
les entreprises privées et l’État.
Historiquement, « l’accumulation primitive » du capital des pays de
l’ex-bloc soviétiques s’est produite grâce à la désintégration de l’État
et de l’économie soviétiques. Le politologue Steven Solnick qualifie de
« pillage de l’État » le processus par lequel les membres de la
nouvelle classe dirigeante ont privatisé ce qui appartenait aux entités
publiques – souvent pour quelques dollars. Ils ont bien sûr tiré profit
de leurs relations informelles avec les dirigeants du nouvel l’État, et
des lacunes d’un système juridique intentionnellement conçu pour
faciliter l’évasion fiscale et la fuite des capitaux.
L’économiste marxiste russe Ruslan Dzarasov désigne cette
accumulation initiale comme une « rente d’initié ». On retrouve bien sûr
ces pratiques dans d’autres parties du monde, mais le rôle de l’État
est ici bien plus important dans la création et la reproduction de la
classe dirigeante russe, en raison de la nature de la transformation
post-soviétique.
Ces phénomènes sont plus généralement subsumés par le concept de
« capitalisme politique » – ou « capitalisme d’État », dans ses
variantes. De nombreux penseurs, comme le sociologue Hongrois Ivan
Szelenyi, ont développé ce concept traditionnellement défini par Max
Weber comme l’exploitation de la fonction politique par la classe
capitaliste, visant à maximiser l’accumuler de richesses. Partant, les
« capitalistes d’État » – que l’on nommera ici, par commodité de
langage, oligarques – désignent la fraction des détenteurs de
capitaux dont le principal avantage concurrentiel provient de leur
mainmise sur les institutions publiques – contrairement à ceux qui
tirent leur pouvoir d’une main-d’œuvre bon marché ou d’innovations. Les
oligarques n’existent pas seulement dans les pays post-soviétiques : ils
tendent à bourgeonner sur les ruines des États qui ont joué un rôle
structurant dans l’économie, accumulé d’importants capitaux, puis se
sont brutalement ouverts au secteur privé.
Il est possible, sur ces fondements, d’aller au-delà des déclarations
du Kremlin portant sur sa « souveraineté » ou ses « sphères
d’influence ». Si les avantages que procurent l’État aux oligarques sont
fondamentaux pour l’accumulation de leur richesse, ils n’ont d’autre
choix que de défendre le territoire sur lequel ils exercent un tel
contrôle.
Ce besoin de « marquer le territoire » est moins fondamental pour les
autres catégories de détenteurs de capitaux. Les classes dominantes
« traditionnelles » ne dirigent pas l’État directement : en Occident,
les institutions étatiques jouissent d’une autonomie substantielle par
rapport à la classe dominante, qu’elles servent indirectement en
établissant des règles qui permettent leur l’accumulation. Les
oligarques, en revanche, n’exigentp pas de l’État la simple mise en
place de règles : ils souhaitent un contrôle beaucoup plus immédiat sur
les décideurs politiques – lorsqu’ils n’en sont pas eux-mêmes.
Bien sûr, de nombreuses icônes du capitalisme entrepreneurial
classique ont bénéficié de subventions de l’État, de régimes fiscaux
préférentiels ou de diverses mesures protectionnistes. Mais,
contrairement aux oligarques, leur survie et leur expansion sur le
marché ne dépendent que rarement des partis au pouvoir ou des régimes
politiques en place. Le capital transnational survivrait sans les
États-nations dans lesquels son siège social est situé – comme en
témoigne les projets de villes entrepreneuriales flottantes,
« indépendantes » de tout État-nation, rêvés par les magnats de la
Silicon Valley comme Peter Thiel. Les oligarques, à l’inverse, ne
peuvent survivre dans la concurrence mondiale sans un territoire duquel
ils tirent une rente.
Les conflits de classe à l’ère post-soviétique
Un tel « capitalisme politique » est-il viable sur la longue durée ?
Après tout, l’État doit bien puiser ses ressources quelque part pour
pérenniser cette redistribution ascendante… Comme le note Branko
Milanovic, la corruption demeure un problème endémique du « capitalisme
politique » – que l’on songe simplement à la Chine, modèle le plus
abouti en la matière. Les institutions du Parti communiste se sont
désintégrées et ont été remplacées par des logiques fondées sur des
réseaux de clientélisme. De telles réalités freinent les tendances à la
de modernisation de l’économie. Pour le dire autrement, il n’est pas
possible de voler éternellement à la même source : le « capitalisme
politique » doit muer en une forme qui lui permette de maintenir un taux
de profit élevé via des investissements en capital ou une exploitation
intensive du travail – sans quoi la sources des rentes finira par se
tarir.
Or, le réinvestissement et l’exploitation de la force de travail se
heurtent à des obstacles structurels dans le capitalisme
post-soviétique. D’une part, les oligarques eux-mêmes hésitent à
s’engager dans des investissements à long terme, ayant à l’esprit que la
prospérité de leur modèle dépend de la présence au pouvoir d’un certain
clan. Aussi, il est généralement plus opportun pour eux de transférer
leurs bénéfices vers des comptes offshore, dans une logique de profit
immédiat. D’autre part, la main-d’œuvre post-soviétique, urbanisée et
qualifiée, n’est pas bon marché. Les salaires relativement bas de la
région n’ont été rendu possibles qu’en raison de la vaste infrastructure
matérielle et des institutions de protection sociale que l’Union
soviétique a laissé en héritage. Cet héritage représente un fardeau
énorme pour l’État, mais il n’est pas si facile de l’abandonner sans
provoquer un grognement populaire immédiat.
Dans une logique que l’on peut qualifier de « bonapartiste »,
Vladimir Poutine et son entourage ont cherché à mettre fin à cette
guerre de « tous contre tous » qui a caractérisé les années 1990,
équilibrer les intérêts de certaines fractions de l’élite, et en
réprimer d’autres. Ce, sans altérer les fondements de ce « capitalisme
politique ».
Alors que cette expansion prédatrice du capitalisme russe l’expansion
commençait à se heurter à ses limites internes, les élites ont cherché à
l’externaliser pour soutenir leur taux de rente, en augmentant le
bassin d’extraction. C’est ainsi que l’on peut comprendre
l’intensification des projets d’intégration menés par la Russie comme
l’Union économique eurasiatique. Ceux-ci se sont heurtés à deux
obstacles.
Le premier, relativement mineur, réside dans la résistance des
classes dominantes locales. En Ukraine, les oligarques comptaient bien
conserver leur propre droit souverain à récolter des rentes d’initiés
sur leur territoire. Ils ont alors instrumentalisé le nationalisme
anti-russe pour légitimer leur revendication sur la partie ukrainienne
de l’État soviétique en désintégration – sans réussir à développer un
projet national fondé sur le développement.
Le célèbre titre du livre du second président ukrainien Leonid Koutchma – L’Ukraine n’est pas la Russie
– illustre bien ce problème. Si l’Ukraine n’est pas la Russie, alors
qu’est-elle au juste ? L’échec des oligarques post-soviétiques
non-russes à surmonter la crise de l’hégémonie qu’ils traversaient a
fragilisé leur pouvoir – in fine dépendant du soutien russe, comme en Biélorussie ou au Kazakhstan.
L’alliance entre le capital transnational et les classes moyennes,
représentées par des sociétés civiles pro-occidentales, traçait les
contours d’un projet post-soviétique plus menaçant pour la Russie. Cette
alliance, davantage que les oligarques traditionnels, obérait les
projets d’intégration de la Russie. Une telle configuration offre une
première réponse pour comprendre les raisons de l’invasion de l’Ukraine.
Il faut également rappeler que la stabilisation toute
« bonapartiste » des institutions, imposée par Poutine, a favorisé la
croissance d’une classe moyenne. Si une partie de celle-ci était
financièrement liée au régime, la grande majorité était exclue de ce
« capitalisme politique ». Les principales opportunités de revenus et de
carrière pour ses membres résidait donc dans une intensification des
liens politiques, économiques et culturels avec l’Occident. On ne
s’étonnera donc pas que cette classe moyenne ait été au premier poste de
propagation du softpower occidental.
Ce contre-projet, profondément élitaire par nature, explique son peu
de succès en Russie et dans le reste de l’espace post-soviétique – bien
qu’une alliance avec les factions nationalistes anti-russes aient pu, en
Ukraine et ailleurs, lui fournir une audience non négligeable.
Aujourd’hui encore, la mobilisation des Ukrainiens contre l’agression
russe n’implique pas qu’ils soient unis autour d’un tel projet.
La discussion sur le rôle de l’Occident dans l’invasion russe est
généralement centrée sur la menace que représenterait l’OTAN pour la
Russie. C’est un élément mis en avant par la classe dirigeante russe. Il
est aisé de comprendre pourquoi : la classe oligarchique russe ne
survivrait pas dans un modèle économique « à l’occidentale ». Les
programmes « anti-corruption » mis en avant par les institutions
européennes et nord-américaines constituent une pièce fondamentale dans
leur agenda de lutte contre le « capitalisme politique » : pour les
oligarques russes, le succès de ce programme signifierait la fin de la
poule aux oeufs d’or.
En public, le Kremlin tente de présenter la guerre comme une bataille
pour la survie de la Russie. L’enjeu sous-jacent est cependant la
survie de la classe dirigeante russe et de son modèle oligarchique. La
restructuration « multipolaire » de l’ordre mondial lui fournirait un
certain répit. On comprend donc la rhétorique tiers-mondiste du Kremlin,
qui tente de populariser sa vision géopolitique auprès des élites du
« Sud global ». Celles-ci, à leur tour, obtiendraient le droit à leur
propre « sphère d’influence ».
Crises du bonapartisme post-soviétique
Il faut garder à l’esprit les intérêts contradictoires des classes
oligarchiques post-soviétiques, des classes moyennes et du capital
transnational pour comprendre la genèse du conflit actuel. La crise de
l’organisation politique aux fondements du « capitalisme politique » a
servi de catalyseur.
Les régimes « bonapartistes », comme ceux de Poutine ou d’Alexandre
Loukachenko, s’appuient sur un soutien passif et dépolitisé de la
population. Ils tirent leur légitimité de leur capacité à surmonter le
désastre de l’effondrement post-soviétique – une matrice hégémonique
bien faible. de tels régimes, fortement personnalisés, sont fragiles en
raison des problème de succession. Aucune règle n’émerge pour la
passassion du pouvoir, pas davantage qu’une idéologie à laquelle le
nouveau dirigeant devrait adhérer, qu’un parti ou un mouvement par
lequel il pourrait se légitimer. Aussi la succession constitue-t-elle
l’un des talons d’Achille de l’olgiarchie post-soviétique. Ces phases
constituent des moments de fragilité, durant lesquelles les soulèvements
populaires ont de meilleures chances de réussir.
De tels soulèvements se sont accélérés à la périphérie de la Russie
ces dernières années : Euromaïdan en Ukraine (2014), les soulèvements
arméniens, la troisième révolution au Kirghizistan, le soulèvement raté
en Biélorussie (2020) et plus récemment le soulèvement au Kazakhstan.
Dans les deux derniers cas, le soutien russe s’est avéré structurant
pour assurer la survie du régime. En Russie même, les rassemblements
« Pour des élections équitables » organisés en 2011 et 2012, ainsi que
les mobilisations ultérieures inspirées par Alexeï Navalny, soutenus pas
la classe moyenne pro-occidentale, ne sont pas anodins. À la veille de
l’invasion, l’agitation populaire était en hausse, tandis que les
sondages établissaient une baisse de confiance en Vladimir Poutine – et
une hausse de ceux qui souhaitaient sa mise à la retraite.
Aucun de ces soulèvements n’a pourtant représenté une menace vitale
pour l’ordre oligarchique post-soviétique. Ils n’ont fait que substituer
une fraction de la classe dominante à une autre, aggravant la crise de
la représentation contre laquelle ils étaient précisément apparus –
raison de leur caractère endémique.
Comme le souligne le politologue Mark Beissinger, les phénomènes de
type « Maïdan » constituent des soulèvements civiques et urbains qui,
contrairement aux révolutions sociales du passé n’affaiblissent que
temporairement le régime en cours, par un renforcement conjoncturel de
la « société civile » issue de la classe moyenne. Ils ne parviennent à
instaurer un ordre politique alternatif, pas davantage que des mutations
démocratique durables, encore moins un infléchissement égalitaire des
structures économiques. Dans les pays post-soviétiques, ces soulèvements
n’ont fait qu’affaiblir l’État – et rendre les oligarques locaux plus
vulnérables aux assauts du capital transnational, à la fois directement
et indirectement, notamment via les ONG pro-occidentales.
L’Ukraine constitue un cas d’école. Une série d’agences
« anti-corruption » ont été obstinément promues par le FMI, le G7 et la
« société civile » ukrainienne suite au soulèvement Euromaïdan. Ils
n’ont pourtant mis fin à aucun cas majeur de corruption au cours des
huit dernières années. Leur principale réussite réside dans
l’institutionnalisation de la surveillance des principales entreprises
d’État par des ressortissants étrangers et des militants
anti-corruption, réduisant ainsi les opportunités de récolter des rentes
d’initiés pour les oligarques locaux. Les oligarques russes ont une
bonne raison de craindre les institutions occidentales…
Consolidation de la classe dirigeante russe
Divers facteurs conjoncturels permettraient de comprendre pourquoi
l’invasion a été enclenchée à ce moment précis – et les raisons de son
caractère désastreux : avantage temporaire de la Russie dans les armes
hypersoniques, dépendance de l’Europe en énergie russe, répression de
l’opposition – soi-diant « pro-russe » – en Ukraine, enlisement des
accords de Minsk de 2015, échec des services secrets russes en Ukraine,
etc. Il s’agit ici d’esquisser à grands traits le conflit de classe à
l’origine de l’invasion : celui qui oppose des oligarques souhaitant
soutenir leur taux de rente par une expansion territoriale, et un
capital transnational allié aux classes moyennes exclues de ce
« capitalisme politique ».
Ce conflit ne se manifeste pas seulement par cette facette
impérialiste. La répression qui s’abat sur les manifestants en
Biélorussie et en Russie même en découle également. L’intensification de
la crise d’hégémonie post-soviétique et l’incapacité de la classe
dirigeante à développer un leadership politique, moral et intellectuel
constituent des causes déterminantes dans l’escalade de la violence.
La classe dirigeante russe est diverse. Si certaines fractions
subissent de lourdes pertes du fait des sanctions occidentales,
l’autonomie partielle du régime russe par rapport à celles-ci lui permet
de poursuivre des « intérêts collectifs » de long terme. Dans le même
temps, la crise des régimes périphériques exacerbe la menace qui pèse
sur la classe dirigeante russe. Les fractions les plus
« souverainistes » des oligarques russes ont la main haute par rapport
aux plus « compradores », – même si celles-ci comprennent qu’avec la
chute du régime, ils seraient également perdants.
En déclenchant la guerre, le Kremlin a cherché à contrecarrer cette
menace – et à tendre vers l’horizon d’une restructuration
« multipolaire » de l’ordre mondial. Comme le suggère Branko Milanovic,
la guerre confère une légitimité au découplage entre la Russie et
l’Occident malgré ses coûts extraordinairement élevés – et plus le temps
passe, plus la machine arrière paraît improbable. Elle permet également
à la classe dirigeante russe de renforcer son organisation politique et
sa légitimité idéologique. Ne voit-on pas poindre les signes d’une
transformation vers un régime politique autoritaire, idéologisé et
mobilisateur ?
Pour Poutine, il s’agit essentiellement d’une autre étape dans le
processus de consolidation post-soviétique entamé au début des années
2000 en apprivoisant les oligarques russes. Le récit de la prévention
des catastrophes et de la restauration de la « stabilité » constituait
une première étape. Un nationalisme conservateur plus articulé lui
emboîte le pas, dirigé vers des acteurs étrangers comme les Ukrainiens
et l’Occident, ou intérieurs – les « traîtres » cosmopolites.

/image%2F1449569%2F20230613%2Fob_9e1a60_francois-boulo-avis.jpg)